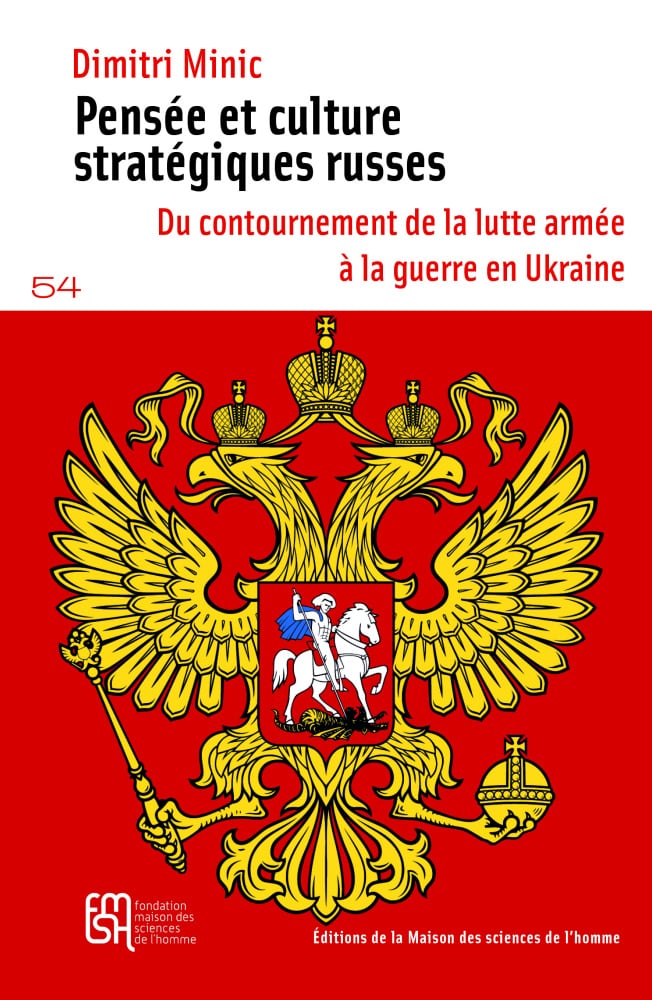Quelques jours après l’appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, l’onde de choc continue à se faire ressentir en Ukraine et en Europe. Une crainte ne cesse de grandir : que le nouveau président américain – avide d’un “deal” pour mettre fin à la guerre – ne cède aux exigences de son homologue russe. D’ores et déjà, la nouvelle administration a exclu toute adhésion de l’Ukraine à l’Otan, tout comme un retour du pays à ses frontières de 2014 – deux demandes fondamentales pour Kiev. “Les négociations n’ont même pas encore commencé qu’une partie des objectifs maximalistes russes ont déjà été théoriquement atteints”, souligne Dimitri Minic, chercheur au centre Russie-Eurasie de l’Institut français des relations internationales et auteur de Pensée et culture stratégiques russes : du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine (Ed. Maison des sciences de l’homme, 2023). Ce spécialiste insiste aussi sur le fait que de fortes concessions ukrainiennes pourraient entraîner un vif ressentiment envers l’Occident. Avec le risque de l’arrivée au pouvoir à Kiev d’un gouvernement prorusse, voire d’un “coup d’État militaire”. Entretien.
L’Express : Quels sont les principaux objectifs de Vladimir Poutine dans ces négociations ?
Dimitri Minic : Poutine n’est pas pressé de négocier sur l’Ukraine, à la fois parce que le rapport de force lui est objectivement favorable – d’autant plus avec une administration américaine néo-isolationniste – et parce que la guerre a reconfiguré les équilibres internes en Russie. Or une véritable paix pourrait les déstabiliser. Il faut garder à l’esprit que ce pays n’a pas envahi l’Ukraine pour des “terres” comme le croit naïvement – ou feint de le croire – Donald Trump. Moscou souhaite une vassalisation de l’Ukraine.
Cela passe par une “finlandisation” du pays, c’est-à-dire sa non-adhésion à l’Otan, l’interdiction d’installer des infrastructures militaires occidentales et de livrer du matériel militaire américain ou européen. En outre, Poutine exige une démilitarisation de l’Ukraine et un changement de régime à Kiev qui lui serait favorable. A cela s’ajoute la cession des territoires annexés, y compris les parties encore contrôlées par l’Ukraine, et, peut-être, d’autres territoires dans les régions de Kharkiv, Odessa et Dniepropetrovsk. Soit Donald Trump permet au Kremlin de se rapprocher de cet objectif de vassalisation, soit il ne le désire pas, et les négociations échoueront.
Flatter Donald Trump et louer son “bon sens” peut-il se révéler payant pour Poutine ?
Jusqu’à présent, Poutine semble avoir réussi à “gérer” Donald Trump. Le président russe a répondu par la flatterie aux critiques et aux menaces que son homologue américain, irrité par le rejet russe des propositions américaines en décembre, lui a publiquement adressées en janvier. Poutine a ainsi publiquement loué le “bon sens” de Donald Trump et épousé son récit de la guerre en Ukraine, selon lequel celle-ci n’aurait jamais commencé s’il avait été à la place de Joe Biden. En parallèle, Poutine a réaffirmé ses alliances et partenariats avec l’Iran et la Chine.
Si les troupes nord-coréennes ont été retirées du front dans la région russe de Koursk au cours du mois de janvier, il semble que cela soit d’abord lié aux lourdes pertes subies – même si Moscou a pu faire passer cela comme un signe d’ouverture à la partie américaine –, tandis que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé, le 9 février, son engagement à soutenir militairement la Russie. Donald Trump a donc peut-être été sensible aux manœuvres de Poutine, y compris à ses flatteries, mais ce n’est pas déterminant. Ce qui l’est en revanche, c’est l’indifférence de Trump au sort de l’Ukraine et de l’Europe. L’asymétrie des enjeux en Ukraine, existentiels pour le Kremlin, et non existentiels pour la nouvelle administration américaine, est tout aussi déterminante.
Doit-on craindre que Trump se contente d’un mauvais accord pour l’Ukraine et les Européens, du moment qu’il peut avoir un “deal” ?
Que veut Trump ? Un deal rapide pour être sacré faiseur de paix, ce que le Kremlin a très bien compris. Que veut Poutine ? Vassaliser l’Ukraine, ce que Trump ne semble pas réellement comprendre. Mais il devra vite s’en rendre compte s’il souhaite faire un deal avec Poutine. Ce dernier n’est pas pressé : il est persuadé de pouvoir l’emporter sur le champ de bataille. D’autant plus que dans le même temps, Washington est réticent à utiliser la plupart des leviers dont il dispose sur la Russie, à savoir, d’une part, un soutien financier et militaire à l’Ukraine, sans parler d’un envoi de troupes au sol, et, d’autre part, des sanctions, des droits de douane et l’utilisation des actifs russes gelés. Trump refuse également que les forces de garantie de sécurité, censées garder une zone démilitarisée, soient américaines. Il laisse donc la responsabilité de la création de ces forces aux Européens.
Les négociations n’ont même pas encore commencé qu’une partie des objectifs maximalistes russes ont déjà été théoriquement atteints : acceptation de facto des territoires annexés et non-adhésion de l’Ukraine à l’Otan. L’exclusion partielle ou totale de Volodymyr Zelensky des négociations ainsi que la mention par Donald Trump de mauvais sondages de popularité du président ukrainien et de la nécessité de nouvelles élections, sont un pas vers l’acceptation d’une autre exigence fondamentale de Moscou : le changement de régime. Si Trump veut un accord avec Poutine, ces éléments devront être acquis avant même la négociation, laquelle portera d’abord et avant tout sur : les contours de la finlandisation, la réduction drastique de la taille de l’armée ukrainienne, la levée partielle ou totale des sanctions occidentales contre la Russie, et enfin la création d’une nouvelle architecture de sécurité en Europe, incluant un recul de l’Otan.
Cela semble totalement inacceptable…
La transparence de la politique isolationniste américaine a dès le début affaibli la main de l’administration américaine. Cette stratégie perdante a culminé le 12 février avec les déclarations de Trump et de son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Ce dernier a tenté de reculer, le lendemain, sur le refus américain de faire entrer l’Ukraine dans l’Otan en indiquant que c’est à Trump de prendre cette décision. Le vice-président américain, J. D. Vance, a également essayé de rattraper le coup, le même jour, en rappelant que des sanctions et même des “moyens de pression militaires” n’étaient pas exclus si la Russie ne voulait pas faire d’accord.
Mais il sera difficile pour la partie américaine d’effacer des déclarations comme “je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrivera à l’Ukraine d’une manière ou d’une autre”, lancée par J.D. Vance en juillet dernier, ou celle insistant sur le fait que Washington ne veut pas qu’un seul Américain soit impliqué dans une force de maintien de la paix ou de garantie de sécurité à l’Ukraine. Trump est prêt à d’importantes concessions car il n’y a aucun autre véritable enjeu pour lui que de faire la paix, qu’importent les conditions pour l’Ukraine et l’Europe. Il maquillera ces concessions en “meilleur deal de toute l’histoire de l’humanité” s’il obtient ce qu’il veut de la Russie. Or ce qu’il veut n’a rien à voir avec la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Un mauvais “deal” ne constituerait-il pas une humiliation pour Trump ?
Nous n’avons pas tous la même définition de ce qu’est un bon ou un mauvais “deal”. Pour Trump, le mauvais “deal”, c’est d’une part de continuer à financer une guerre dont il estime ne tirer aucun avantage, et d’autre part de s’aliéner durablement la Russie, alors qu’il espère tirer profit d’une bonne entente avec elle, en la détachant de la Chine. Compte tenu de l’inflexibilité de Moscou – qui ne “lâchera” pas la Chine pour les beaux yeux de Washington – et du désir pressant de Trump de faire la paix, un bon “deal” pour ce dernier serait une paix où les concessions à la Russie ne se verraient pas trop.
Malgré un ton très conciliant et des concessions théoriques avant même que les négociations aient commencé, Trump pourrait aussi très bien refuser les exigences maximalistes de Moscou, se lasser de la raideur du Kremlin et finir par renforcer les sanctions tout en poussant les Ukrainiens et Européens à acheter des armes américaines. En résumé, les laisser se débrouiller. Après tout, Trump estime que c’est une affaire européenne. La seule menace que Washington semble être prêt à mettre en œuvre est d’ordre économique : imposer ou renforcer des sanctions et augmenter les droits de douane. Cela ne changera nullement le cours de la politique russe en Ukraine et en Europe. En revanche, des menaces militaires, sans parler d’une tentative de mettre en œuvre ces menaces, déboucheront, selon leur nature, sur une rhétorique agressive que nous connaissons bien chez Poutine : invoquer le spectre d’une Troisième Guerre mondiale ou d’une apocalypse nucléaire.
L’Ukraine aurait-elle la capacité de refuser un mauvais accord ?
Bien sûr qu’elle en a la capacité et elle le fera peut-être. Rien de consistant ne se fera en dehors de la volonté des Ukrainiens. Mais il est à craindre que Kiev doive choisir entre la peste et le choléra : refuser les conditions négociées par Donald Trump et Vladimir Poutine, et continuer une guerre qu’elle a peu de chances de remporter sans un soutien ferme de l’Occident ; ou accepter ces conditions et donc renoncer, tôt ou tard, à son indépendance. L’hostilité des Ukrainiens envers la Russie est légitimement et durablement enracinée, mais le ressentiment envers Washington et, peut-être encore davantage, envers l’Europe, sera fort.
La lassitude et l’acceptation, au moins temporaire, d’une férule prorusse ne doivent pas être exclues. Que ces autorités conciliantes avec la Russie ou simplement prorusses arrivent au pouvoir à la suite de négociations qui auraient abouti, ou bien après une victoire militaire en Ukraine, ou encore à plus long terme, comme ce fut le cas en Géorgie. Écœurés par les Occidentaux, certains membres de l’élite ukrainienne pourraient aussi tenter de dialoguer directement avec la Russie en excluant les Occidentaux de l’équation et en renonçant eux-mêmes aux partenariats de toute sorte avec ces derniers. Le Kremlin serait probablement ravi et peut-être plus “clément”. La perspective de fortes concessions ukrainiennes et d’un abandon complet des Occidentaux pourrait tout aussi bien déboucher sur un coup d’État militaire, voire une tentative désespérée d’obtenir l’arme atomique. Ce qui est certain, c’est que la volonté de la population ukrainienne sera décisive, rien ne se jouera en dehors d’elle.
Source